|
 autre
choix d'écrits autre
choix d'écrits
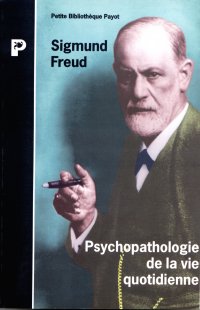 La
vie banale de chaque jour n’est-elle pas aux antipodes des troubles
psychiques ? Freud détruit cette illusion car, entre
le normal et le pathologique, il n’existe pas de frontières
étanches. Oublier un nom, casser un bibelot familier,
se tromper de clefs, commettre un lapsus, tous ces petits accidents
ordinaires doivent s’interpréter comme des manifestations
de l’inconscient. En effet celui-ci travaille sans cesse, infatigablement. La
vie banale de chaque jour n’est-elle pas aux antipodes des troubles
psychiques ? Freud détruit cette illusion car, entre
le normal et le pathologique, il n’existe pas de frontières
étanches. Oublier un nom, casser un bibelot familier,
se tromper de clefs, commettre un lapsus, tous ces petits accidents
ordinaires doivent s’interpréter comme des manifestations
de l’inconscient. En effet celui-ci travaille sans cesse, infatigablement.
Freud a montré comment le rêve était la
voie royale d’accès à l’inconscient. Il dessine
dans cet ouvrage de 1901 d’autres chemins cers cette part de
chaque sujet qui échappe à son contrôle
et qui, par ses manifestations, traduit ses désirs.
Dans : « Psychopathologie de la vie quotidienne »,
la virtuosité de Freud à analyser des formations
de l’inconscient émerveille et apporte au lecteur le
plaisir de voir, à travers une foule de cas souvent pittoresques,
des énigmes résolues.
Table
1. Oubli de noms propres
2. Oubli de mots appartenant à des langues étrangères
3. Oubli de nom et de suites de mots
4. Souvenirs d’enfance et « souvenirs-écrans
»
5. Les lapsus
6. Erreurs de lecture et d’écriture
7. Oubli d’impression et de projets
8. Méprises et maladresses
9. Actes symptomatiques et accidentels
10. Les erreurs
11. Association de plusieurs actes manqués
12. Déterminisme. Croyance au hasard et superstition.
Points de vue
[...........................................]
1. Oubli de noms propres
... Je prétends qu’il existe, entre le nom ou les noms
de substitution et le nom cherché, un rapport possible
à trouver, et j’espère que, si je réussis
à établir ce rapport, j’aurai élucidé
le processus de l’oubli de noms propres.
Oubli, mais aussi remémoration fautive. A celui qui
s’efforce de se rappeler le nom qui lui échappé,
d’autres noms « des noms de substitution » viennent
à la conscience
S.F tentait de se remémorer le nom du maître qui
avait créé les fresques de la cathédrale
d’Orvieto. Au lieu de dire Signorelli, deux autres noms de peintres
s’imposèrent à lui : Botticelli et Boltraffio.
Circonstances : « je faisais une excursion en voiture
avec un étranger, de Raguse en Dalmatie à une
station d’Herzégovine. Ils parlaient de voyage en Italie,
et donc, de la cathédrale d’Orvieto.
Mais il est important de dire que peu de temps avant de parler
des fresques du célèbre peintre, S.F parlait des
turcs vivant en Bosnie et en Herzégovine. Il avait changé
de conversation pour fuir le sujet. Il disait des turcs qu’ils
avaient l’habitude de se montrer plein de confiance envers le
médecin et plein de soumission envers le destin. Quand
on leur dit qu’on ne peut plus rien pour un malade ils répondent
: »Herr, je sais que s’il pouvait être sauvé,
tu l’aurais sauvé ! »
De plus, S.F se souvient qu’il voulait aussi raconter une seconde
anecdote : « les turcs mettent la jouissance sexuelle
au-dessus de tout, et lorsqu’ils sont atteints de troubles sexuels,
ils sont pris d’un désespoir insurmontable. L’un des
patients d’un confrère lui avait dit un jour : «
tu le sais bien, Herr, quand ça ne marche plus, alors
la vie ne vaut plus rien ». Mais Il s’abstint d’aborder
cette conversation devant un étranger.
S.F voulait éviter le thème « mort et sexualité
» car il était sous le coup d’une nouvelle qu’il
avait reçue à peine quelques semaines auparavant
durant un bref séjour à Trafoï. Un patient
pour lequel il s’était donné bc de peine venait
de mettre fin à ses jours à cause d’un trouble
sexuel incurable. D’où la concordance >Trafoï-Boltraffio<
« Je voulais donc oublier quelque chose que j’avais oublié.
Je voulais, en vérité, oublier autre chose que
le nom du maître d’Orvieto ; mais cette autre chose parvint
à établir une liaison associative avec le nom
de celui-ci. »
2. Oubli de mots appartenant à des langues étrangères
S. Freud nous expose le cas d’un jeune homme de formation universitaire
rencontré au cours d’un voyage de vacances.
La conversation portant sur la situation sociale de chacun,
et le jeune homme ambitieux, se plaignait de l’état d’infériorité
auquel était condamnée sa génération.
Il conclut par le célèbre vers de Virgile
: Exoriar(e) aliquis
nostris ex ossibus altor !, mais ne parvient
pas à reconstituer entièrement la citation puisqu’il
oublie aliquis.
S. Freud va démontrer que cet oubli n’est pas
dû au hasard.
Il avait mis en évidence un premier mécanisme
de l’oubli avec le cas *Signorellis, il va, avec le cas aliquis,
mettre en évidence un second mécanisme de l’oubli
« consistant dans la perturbation d’une idée par
une contradiction intérieure et inconsciente venant d’une
source refoulée ».
Alors que pour signorellis, c’est le sujet de la conversation
qui est en cause.
Le jeune homme, après s’être plaint, annonce
qu’une nouvelle génération viendra qui vengera
les opprimés d’aujourd’hui. L’idée de postérité
qu’il émet est en contradiction avec sa propre postérité
qu’il redoute. Il fait donc un blocage sur le mot aliquis.
S.Freud lui demande d’exprimer ce qui lui vient à
l’esprit lorsqu’il entend ce mot.
- Il fait tout d’abord une décomposition du mot en a
et liquis
- Il pense à Reliques, liquidation, liquide, fluide
- Il pense à Simon de trente dont il a vu les reliques
- Il pense à un article de journal : »l’opinion
de st Augustin sur les femmes »
- Il pense à un vieillard, Benoît
- Après cette série de st et de pères lui
vient st janvier et le miracle du sang (On conservait le sang
de St Janvier, dans une église, (dans une fiole) > miracle
= il se liquéfiait tous les ans. Le peuple était
mécontent lorsque le miracle était retardé.
>> Là lui vient la source refoulée : La
peur de recevoir la nouvelle que les règles d’une dame
se soient arrêtées, ce qui serait pour lui synonyme
de postérité.
... Nous venons de constater l’existence d’un deuxième
mécanisme de l’oubli, consistant dans la perturbation
d’une idée par une contradiction intérieure venant
d’une source refoulée.
3. Oubli de noms et de suites de mots
Lorsque j’analyse les cas d’oubli de noms que j’ai observés
sur moi-même, je constate presque régulièrement
que le nom oublié se rapporte à un sujet qui touche
ma personne de près et est capable de provoquer en moi
des sentiments violents, souvent pénibles.
... Un de mes patients me prie de lui indiquer une station thermale
sur la Riviera. Je connais une station de ce genre tout près
de Gênes, je me rappelle même le nom du collègue
allemand qui y exerce, mais je suis incapable de nommer la station
que je crois pourtant bien connaître. Il ne me reste qu’à
prier le patient d’attendre quelques instants... « Et
dire que c’est toi qui oublies son nom ! Il s’appelle Nervi.
» C’est que Nervi sonne comme Nerven (nerfs), et les nerfs
constituent l’objet de mes préoccupations constantes.
... C’est comme si quelque chose me poussait à rapporter
à ma propre personne tout ce que j’entends dire et raconter
concernant des tiers, comme si tout renseignement relatif à
des tiers éveillait mes complexes personnels. Il ne s’agit
certainement pas là d’une particularité individuelle...
4. Souvenirs d’enfance et « souvenirs-écrans
»
... Tout ce que je me propose de faire aujourd’hui, c’est de
montrer la similitude qu’il existe entre l’oubli de noms accompagné
de faux souvenirs et la formation de souvenirs-écrans.
... Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit de défectuosités
de la mémoire, laquelle reproduit non le souvenir exact,
mais quelque chose qui le remplace. Dans l’oubli de noms, la
mémoire fonctionne, mais en fournissant des noms de substitution.
Dans le cas de souvenirs-écrans, il s’agit d’un oubli
d’autres impressions, plus importantes. Dans les deux cas, une
sensation intellectuelle nous avertit de l’intervention d’un
trouble dont la forme varie d’un cas à l’autre. Dans
l’oubli de noms, nous savons que les noms de substitution sont
faux ; quant aux souvenirs-écrans, nous nous demandons
seulement avec étonnement d’où ils viennent.
... Certains souvenirs sont déformés, incomplets
ou ont subit un déplacement dans le temps et dans l’espace...
Au cours de la vie ultérieurs, des forces puissantes
ont influencé et façonné la faculté
d’évoquer les souvenirs d’enfance, et ce sont probablement
ces mêmes forces qui, en général, nous rendent
si difficile la compréhension de nos années d’enfance.
|
... Pour les souvenirs d’enfance, on observe, pour ainsi
dire, la même régression que pour les rêves
: ces souvenirs prennent un caractère plastiquement
visuel, même chez les personnes dont les souvenirs ultérieurs
sont dépourvus de tout élément visuel.
C’est ainsi que les souvenirs visuels se rapprochent du type
des souvenirs infantiles.
... Tout cela nous oblige à admettre que ce qu’on trouve
dans les soi-disant souvenirs de la première enfance,
ce ne sont pas les vestiges d’événements réels,
mais une élaboration ultérieure de ces vestiges,
laquelle a dû s’effectuer sous l’influence de différentes
forces psychiques intervenues par la suite. C’est ainsi que
les « souvenirs d’enfance » acquièrent,
d’une manière générale, la signification
de « souvenirs-écrans ».
5. Les lapsus
Dans un article destiné au grand public : « Comment
on commet un lapsus », Meringer fait ressortir la signification
pratique que possèdent dans certains cas les substitutions
de mots, celles notamment où un mot est remplacé
par un autre, d’un sens opposé. « On se rappelle
encore la manière dont le président de la Chambre
des Députés autrichienne a, un jour, ouvert
la séance : « Messieurs, dis-il, je constate
la présence de tant de députés et déclare,
par conséquent, la séance (close) ». c’est
que dans son for intérieur, le président «
souhaitait » pouvoir enfin clore cette séance
dont il n’attendait rien de bon.
6. Erreurs de lecture et d’écriture
Il existe, entre les lapsus, d’une part, les erreurs de lecture
et d’écriture, d’autre part, une affinité telle
que les points de vue adoptés et les remarques formulées
concernant les premiers s’appliquent parfaitement à
ces dernières.
7. Oubli d’impressions et de projets
... J’ai trouvé notamment que « dans tous les
cas l’oubli était motivé par un sentiment désagréable
».
... IL est deux situations dans la vie où le profane
lui-même se rend compte que l’oubli de projets n’est
nullement un phénomène élémentaire
irréductible, mais autorise à conclure à
l’existence de motifs inavoués. Je veux parler de l’amour
et du service militaire. Un amoureux qui se présente
à un rendez-vous avec un certain retard aura beau s’excuser
auprès de sa dame en lui disant qu’il avait oublié
ce rendez-vous. Elle ne tardera pas à lui répondre
: « Il y a un an, tu n’aurais pas oublié. C’est
que tu ne m’aimes plus. »
8. Méprises et maladresses
Au travail, déjà mentionné, de Meringer
et Mayer j’emprunte encore le passage suivant :
« Les lapsus de la parole ne sont pas des phénomènes
isolés. Ils correspondent aux erreurs auxquelles sont
sujettes les autres activités des hommes et qui sont
connues sous la dénomination absurde d’oublis. »
Je ne suis donc pas le premier à avoir attribué
un sens et une intention aux petits troubles fonctionnels
de la vie quotidienne.
... Les maladresses servent les intentions inavouées.
... Lorsqu’un membre de ma famille se plaint de s’être
mordu la langue, écrasé un doigt, etc., je ne
manque jamais de lui demander : « Pourquoi l’as-tu fait
? Mais je me suis moi-même écrasé le pouce,
un jour où l’un de mes jeunes patients m’a fait part,
au cours de la consultation, de son intention (qui n’était
d’ailleurs pas à prendre aux sérieux) d’épouser
ma fille aînée, alors qu’elle se trouvait précisément
dans un sanatorium et que son état de santé
m’inspirait les plus graves inquiétudes.
... Je connais plus d’un soi-disant « accident »
malheureux (chute de cheval ou de voiture) qui, analysé
de près autorise l’hypothèse d’un suicide inconsciemment
consenti.
9. Actes symptomatiques et accidents
Les actes accidentels, dont il sera question dans ce chapitre,
ne se distinguent des méprise que par le fait qu’ils
ne recherchent pas l’appui d’une intention inconsciente et
n’ont pas besoin d’un prétexte. On les accomplit, «
sans penser à rien à leur propos », «
d’une façon purement accidentelle », «
comme si l’on voulait seulement occuper ses mains »,
et l’on considère que cette explication doit mettre
fin à tout examen ultérieur quant à la
signification de l’acte.
... J’ai cru pouvoir conclure que ces actes méritent
plutôt le nom de « symptomatique ». Ils
expriment quelque chose que l’auteur de l’acte lui-même
ne soupçonne pas et qu’il a généralement
l’intention de garder pour lui, au lieu d’en faire part aux
autres.
... La moisson la plus abondante de ces actes accidentels
ou symptomatiques nous est d’ailleurs fournie par les résultats
du traitement psychanalytique des névroses.
... Les actes symptomatiques, dont on trouve une variété
inépuisable aussi bien chez l’homme sain que chez l’homme
malade, méritent notre intérêt pour plus
d’une raison. Ils fournissent au médecin des indications
précieuses qui lui permettent de s’orienter au milieu
de circonstances nouvelles ; elles révèlent
à l’observateur profane tout ce qu’il désir
savoir, et quelquefois même plus qu’il ne désire.
... Nous connaissons les actes symptomatiques accomplis par
des époux et qui consistent à enlever et à
remettre machinalement leur alliance...
10. Les erreurs
... Nous parlons « d’erreur », au lieu de parler
de « faux souvenir », lorsque dans les matériaux
psychiques qu’ont veut reproduire on tient à mettre
l’accent sur leur réalité objective, c’est-à-dire
lorsqu’on veut se souvenir d’autre chose que d’un fait de
la vie psychique de la personne qui cherche à se souvenir,
d’une chose pouvant être confirmée ou réfutée
par le souvenir d’autres personnes.
... Donc, ici encore il s’agissait d’une erreur passée
inaperçue et constituant comme une revanche pour un
refoulement ou une suppression intentionnels.
... Mais, en réalité, j’avais totalement oublié
de préparer ces livres, car je n’approuvais pas tout
fait le voyage de mon malade, dans lequel je voyais une interruption
inutile du traitement. Je jette un rapide coup d’œil à
ma bibliothèque, la recherche des deux livres que j’avais
promis à mon malade... Je n’ignorais pas que les Médicis
n’avaient rien à voir avec Venise ; mais au moment
où j’enlevais ce dernier livre du rayon de la bibliothèque,
je ne pensais pas du tout qu’un ouvrage sur les Médicis
n’avait rien à apprendre à quelqu’un qui s’intéressait
à Venise.
... Toutes les fois où j’essaie de déformer
un fait, je commets une erreur ou un autre acte manqué
qui révèle mon manque de sincérité.
11. Association de plusieurs actes manqués
12. Déterminisme, croyance au hasard
et superstition. Points de vue
Certaines insuffisances de notre fonctionnement psychique
et certains actes en apparence non-intentionnels se révèlent,
lorsqu’on les livre à l’examen psychanalytique, comme
parfaitement motivés et déterminés par
des raisons qui échappent à la conscience.
... Ce qui me distingue d’un homme superstitieux, c’est donc
ceci : « Je ne crois pas qu’un événement,
à la production duquel ma vie psychique n’a pas pris
part, soit capable de m’apprendre des choses cachées
concernant l’état à venir de la réalité
; mais je crois qu’une manifestation non intentionnelle de
ma propre activité psychique me révèle
quelque chose de caché qui, à son tour, n’appartient
qu’à ma vie psychique : je crois au hasard extérieur
(réel), mais je ne crois pas au hasard intérieur
(psychique). C’est le contraire du superstitieux : il ne sais
rien de la motivation de ses actes accidentels et actes manquées,
il croit par conséquent au hasard extérieur
; en revanche, il est porté à attribuer au hasard
extérieur une importance qui se manifestera dans la
réalité à venir, et à voir dans
le hasard un moyen par lequel s’expriment certaines choses
extérieures qui lui sont cachées.
... En ce qui concerne les quelques rares et rapides sensations
de « déjà vu » que j’ai éprouvées
moi-même, j’ai toujours réussi à leur
assigner pour origine les constellation affectives du moment.
« Il s’agissait chaque fois du réveil de conceptions
et de projets imaginaires qui correspondait, chez moi, au
désir d’obtenir une amélioration de ma situation
».
J’accepterai
volontiers toute remarque au sujet d'une inexactitude quelconque
concernant les écrits,
et serai enchanté de recevoir
par e-mail des résumés d’œuvres de la part de
personnes désireuses d’enrichir dicopsy.
|